Introduction : Pourquoi tant d’idées reçues autour de la facture électronique ?
La facture électronique fait l’objet d’une réforme d’envergure qui s’imposera progressivement à toutes les entreprises assujetties à la TVA en France. Prévue initialement pour entrer en vigueur à partir de 2024, sa mise en œuvre a été reportée, mais non abandonnée. Désormais, un calendrier révisé encadre son déploiement à partir de septembre 2026, avec des obligations qui évolueront selon la taille des structures.
Entre les évolutions techniques, les changements réglementaires, les multiples acteurs impliqués (plateformes, éditeurs, administration fiscale), et les termes parfois flous utilisés dans la communication officielle, de nombreuses idées reçues ont émergé. Certaines entreprises pensent qu’elles ne sont pas concernées, d’autres supposent que leurs outils actuels suffiront, ou encore que la réforme apportera peu de bénéfices. Ces idées, souvent issues d’une compréhension partielle des textes ou d’informations anciennes, peuvent freiner la préparation et augmenter les risques de non-conformité.
Il est donc essentiel de clarifier ce qui relève de la réalité et ce qui relève de l’idée fausse. Cet article a pour objectif de revenir sur dix affirmations fréquentes entendues dans les entreprises, et de les confronter aux obligations réelles issues du cadre réglementaire. En comprenant mieux les contours de la facturation électronique, il devient possible de s’y préparer sereinement, quel que soit son profil ou son niveau d’équipement.
La réforme en bref : obligations, calendrier, périmètre
Qui est concerné ?
La réforme de la facture électronique concerne l’ensemble des entreprises assujetties à la TVA, qu’elles soient établies en France métropolitaine ou en outre-mer. Il ne s’agit pas uniquement des grandes structures : les TPE, PME, micro-entreprises, auto-entrepreneurs et entreprises de taille intermédiaire sont également concernées, dès lors qu’elles réalisent des transactions soumises à la TVA.
Cette généralisation repose sur un principe simple : uniformiser les formats, sécuriser la transmission des factures, et fiabiliser les données transmises à l’administration fiscale. Même les entreprises qui bénéficient de la franchise en base de TVA peuvent être soumises à certaines obligations, comme la réception de factures électroniques ou le e-reporting de certaines opérations.
Quelles obligations à venir ?
La réforme repose sur trois axes principaux :
- Émettre des factures électroniques via une plateforme de dématérialisation partenaire (ou plateforme agréée) ;
- Recevoir les factures de ses fournisseurs au format électronique structuré, quel que soit son outil interne ;
- Transmettre à l’État certaines données de facturation, via le e-reporting, pour les prestations de services et ventes non couvertes par le e-invoicing (notamment le B2C ou l’international).
Les obligations varient selon le type d’opérations réalisées et le statut de l’entreprise, mais elles s’imposeront à tous à court terme.
Le bon calendrier
Le calendrier officiel, tel que défini dans la loi de finances 2024, est le suivant :
- 1er septembre 2026 :
- Toutes les entreprises assujetties à la TVA devront pouvoir recevoir des factures électroniques.
- Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire devront également être capables d’émettre ces factures via une plateforme agréée.
- 1er septembre 2027 :
- Ce sera au tour des PME, TPE et micro-entreprises de se conformer à l’obligation d’émission.
Ce dispositif progressif vise à laisser le temps aux acteurs les moins équipés de s’adapter, notamment en choisissant une solution compatible avec leur organisation.
Ce qui change, ce qui reste
Ce qui change :
La facture papier ou le simple envoi de fichier PDF par e-mail ne sera plus autorisé entre assujettis à la TVA. Toutes les factures devront passer par une plateforme agréée, capable de gérer à la fois la transmission, la réception et, si nécessaire, le e-reporting. Les données devront être structurées et conformes à un format électronique reconnu.
Ce qui ne change pas :
Les obligations fiscales habituelles (comme la déclaration de TVA) restent en place. La facturation électronique ne dispense pas l’entreprise de ses responsabilités : elle doit toujours s’assurer de la vérification des données, de la bonne émission, et de l’exactitude des mentions obligatoires sur ses documents.
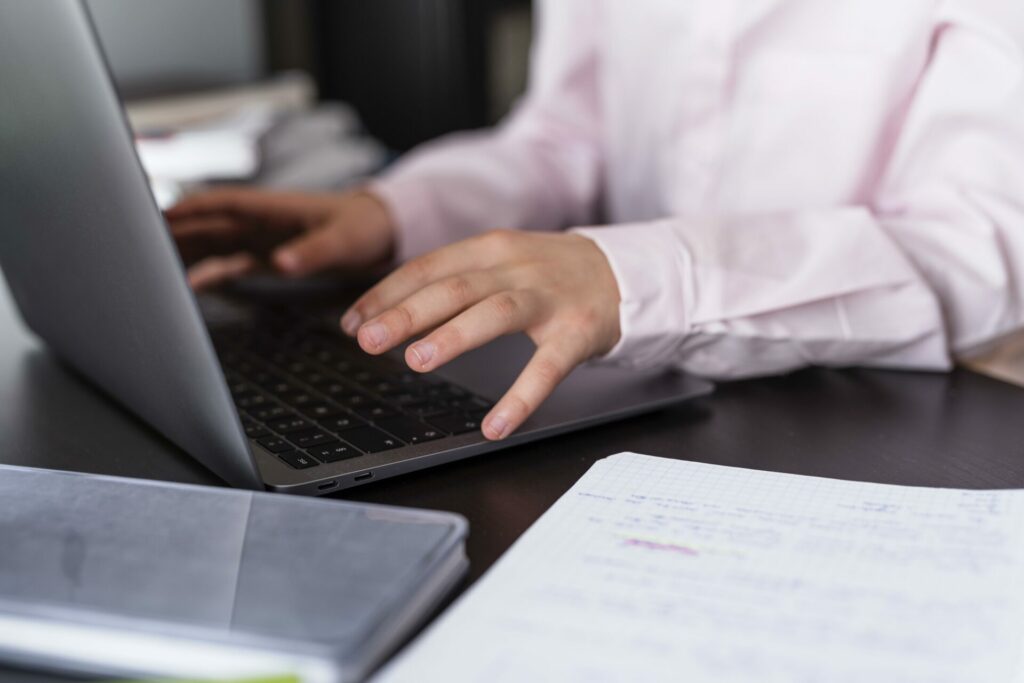
10 idées reçues sur la facture électronique à déconstruire
Idée reçue n°1 – Un PDF envoyé par e-mail, c’est une facture électronique
Beaucoup d’entreprises pensent qu’un simple fichier PDF envoyé par courriel constitue une facture électronique. Cette confusion est compréhensible, car le format PDF est largement utilisé depuis des années dans les échanges professionnels. Pourtant, dans le cadre de la réforme, cette pratique ne sera plus considérée comme conforme.
Une facture électronique, au sens de la réglementation, est une facture émise, transmise et reçue sous un format structuré permettant l’extraction automatique des données. Les formats autorisés sont notamment Factur‑X, UBL ou CII, qui contiennent des blocs d’informations lisibles par les systèmes. Ces formats permettent l’automatisation du traitement comptable et fiscal.
En d’autres termes, un fichier PDF n’est pas interdit, mais il devra être accompagné de données structurées, transmises via une plateforme de dématérialisation agréée. C’est cette combinaison qui constitue une facture électronique conforme. L’envoi d’un document par e-mail sans passer par une plateforme ne suffira plus pour répondre aux obligations légales à compter de septembre 2026.
Idée reçue n°2 – Seules les grandes entreprises sont concernées
Certains dirigeants de TPE ou de micro-entreprises estiment que la réforme vise uniquement les grandes entreprises. Cette perception est renforcée par le calendrier progressif, qui fait entrer les plus grandes structures dans l’obligation d’émission avant les autres. Pourtant, la réalité est différente.
La réforme concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA, sans distinction de taille. À partir du 1er septembre 2026, même les plus petites structures devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. L’émission deviendra obligatoire un an plus tard, au 1er septembre 2027.
Par ailleurs, certaines obligations, comme le e-reporting, peuvent s’appliquer à toutes les entreprises en fonction des opérations réalisées (notamment les ventes à des clients particuliers ou à l’étranger). Il est donc essentiel pour chaque entreprise, quel que soit son statut, de se préparer dès maintenant.
Idée reçue n°3 – Je suis en franchise en base de TVA, donc je ne suis pas concerné
La franchise en base de TVA dispense certaines micro-entreprises de collecter et de reverser la TVA. Cela conduit parfois à croire que ces entreprises ne sont pas concernées par la facturation électronique. Or, ce n’est pas le cas.
Ce qui compte dans la réforme, ce n’est pas le régime fiscal, mais le statut d’assujetti à la TVA. Une entreprise en franchise est tout de même assujettie : elle ne collecte pas la TVA, mais elle entre dans le périmètre de la réforme. Elle devra donc, comme les autres, être en mesure de recevoir des factures électroniques dès septembre 2026. Et si elle réalise certaines prestations de services ou opérations B2C, elle pourra être soumise à l’obligation de e-reporting.
Ignorer cette réalité peut exposer l’entreprise à des retards de traitement, à des factures non conformes ou à des blocages dans les échanges avec des partenaires déjà passés au format électronique.
Idée reçue n°4 – Je peux utiliser le PPF pour tout gérer
Le Portail Public de Facturation (ou PPF) est souvent perçu comme une plateforme utilisable directement par les entreprises pour envoyer ou recevoir leurs factures électroniques, notamment parce qu’il était initialement prévu comme une option possible pour les plus petites structures. Cette interprétation est aujourd’hui dépassée.
Depuis la mise à jour du dispositif, le PPF n’est plus une interface destinée aux utilisateurs finaux, mais un outil technique d’interconnexion entre les plateformes agréées et l’administration fiscale. Il centralise les données issues des factures et du e-reporting, alimente les services de l’État, et tient à jour l’annuaire des entreprises.
Concrètement, les entreprises assujetties à la TVA devront passer par une plateforme de dématérialisation partenaire (également appelée plateforme agréée) ou par un opérateur interconnecté à une telle plateforme. Aucune transmission directe de factures électroniques ne pourra se faire via le PPF.
Croire que le PPF suffira à gérer la facturation électronique revient donc à sous-estimer la nécessité de s’équiper, de paramétrer correctement ses outils, et de choisir un partenaire compatible avec le cadre réglementaire.
Idée reçue n°5 – Je peux continuer à envoyer mes factures par e‑mail ou courrier
L’envoi d’une facture en pièce jointe à un e‑mail ou par voie postale est encore une pratique courante. Pourtant, dans le nouveau cadre défini par la réforme, cette pratique ne sera plus conforme pour les transactions entre assujettis à la TVA établis en France.
À compter du 1er septembre 2026, les entreprises devront recevoir les factures de leurs fournisseurs dans un format électronique structuré, transmis via une plateforme agréée. L’émission devra suivre le même canal selon le calendrier applicable à la taille de l’entreprise. L’objectif est de garantir une transmission sécurisée, standardisée, et accessible aux traitements automatisés, y compris pour les besoins de pré-remplissage des déclarations de TVA.
L’usage du format PDF seul ou de l’envoi par e-mail, sans passer par une plateforme, ne permettra plus de répondre aux obligations légales. C’est un changement majeur pour de nombreuses entreprises, notamment les plus petites, qui devront adapter leurs pratiques de facturation.
Idée reçue n°6 – Je ne facture qu’à des particuliers, je ne suis pas concerné
Certains professionnels estiment que la réforme ne s’applique qu’aux échanges entre entreprises (B2B), et que les activités tournées vers les particuliers sont exclues. C’est partiellement inexact.
Il est vrai que la facturation électronique obligatoire s’appliquera uniquement aux transactions entre assujettis à la TVA établis en France. En revanche, les opérations non concernées par cette obligation — notamment les ventes à des particuliers (B2C), les prestations à des clients étrangers, ou encore certaines opérations non taxables — devront faire l’objet d’un e-reporting.
Ce dispositif complémentaire impose la transmission périodique à l’administration fiscale de certaines données issues des factures, comme le montant hors taxe, le montant de la TVA, le type de prestations de services ou le pays du client. Ces informations devront être transmises par l’intermédiaire d’une plateforme agréée, dans des formats spécifiques et à des fréquences définies.
Penser que l’activité B2C dispense de toute démarche serait donc une erreur. Même sans facturer à d’autres entreprises, une structure reste souvent partiellement concernée par la réforme, au moins pour le e-reporting.
Idée reçue n°7 – Tout sera automatisé, je n’aurai rien à faire
L’un des arguments avancés pour justifier la réforme est la possibilité de pré-remplir les déclarations de TVA grâce aux données collectées automatiquement via la facturation électronique. Cela conduit certaines entreprises à croire qu’elles n’auront plus aucune action à réaliser, ce qui est inexact.
Si le pré-remplissage constitue un réel gain de temps, il ne dispense pas les entreprises de leur responsabilité fiscale. Elles devront continuer à vérifier les factures émises et reçues, à contrôler la cohérence des données, et à valider les montants transmis. Toute erreur ou omission pourra avoir des conséquences sur la déclaration de TVA, et donc sur les obligations de l’entreprise envers l’administration fiscale.
Par ailleurs, certains cas spécifiques (changements de taux, exonérations, opérations mixtes) nécessiteront toujours une intervention humaine, notamment pour ajuster ou compléter les informations transmises. L’automatisation ne signifie donc pas la disparition des contrôles internes, mais leur évolution vers des tâches de vérification, d’analyse et de pilotage.
Idée reçue n°8 – C’est trop compliqué pour une petite entreprise comme la mienne
La réforme de la facture électronique peut sembler complexe au premier abord, surtout pour les structures peu équipées ou non informatisées. Pourtant, elle a été pensée pour être adaptable à la diversité des entreprises, y compris les TPE, micro-entreprises ou auto-entrepreneurs.
De nombreuses plateformes de dématérialisation partenaires proposent aujourd’hui des solutions simples, accessibles depuis un navigateur ou une application mobile, sans besoin d’installer un logiciel métier complexe. Certaines sont même directement intégrées à des outils de gestion courants, notamment les solutions de facturation déjà utilisées.
Il n’est donc pas nécessaire d’investir dans une infrastructure lourde ou de disposer d’un service informatique interne. Ce qui compte, c’est de choisir un prestataire agréé, compatible avec les exigences techniques et les formats attendus (Factur‑X, UBL, etc.), et de s’assurer que les factures sont bien transmises dans le respect des obligations.
L’objectif de la réforme est justement de permettre une mise en conformité progressive, sans exclure les petites structures du dispositif.
Idée reçue n°9 – Je verrai ça plus tard, j’ai le temps
Le calendrier officiel prévoit l’obligation de réception de factures électroniques dès le 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille. L’émission, quant à elle, sera obligatoire à partir du 1er septembre 2027 pour les TPE, PME et micro-entreprises.
Cela peut donner l’illusion d’un délai suffisant. En réalité, les étapes nécessaires à la mise en conformité prennent du temps : mise à jour ou changement de logiciel, choix d’une plateforme agréée, paramétrage, tests, formation des équipes, vérification des flux… Sans parler de l’enregistrement dans l’annuaire du PPF (identification par numéro SIREN, configuration du point de réception, etc.).
Repousser la préparation revient à prendre le risque de se retrouver en difficulté au moment de la bascule. Certaines plateformes peuvent aussi avoir des délais d’intégration. Anticiper permet de choisir sa solution avec sérénité, d’impliquer les bons interlocuteurs, et de commencer à tester les nouveaux processus sans pression.
Idée reçue n°10 – Cela va me coûter trop cher
Le coût est une préoccupation légitime, en particulier pour les petites entreprises ou les structures sans budget dédié à l’informatique. Cependant, l’idée que la réforme impose des dépenses lourdes et inévitables est à nuancer.
Il existe aujourd’hui une offre variée de solutions de facturation électronique, certaines gratuites ou à faible coût, en particulier pour les volumes de factures limités. Les plateformes agréées proposent des modèles tarifaires adaptés à la taille et à l’activité des entreprises.
En parallèle, la réforme permet aussi de générer des économies indirectes : réduction du temps passé sur les relances, amélioration du suivi de la TVA, diminution des erreurs de saisie, simplification des contrôles comptables, archivage facilité.
Plutôt qu’un coût, la facturation électronique peut être vue comme un investissement dans l’efficacité administrative, avec un retour sur investissement visible à moyen terme. Ce point mérite d’être évalué au cas par cas, en fonction des besoins réels et des outils déjà en place.

Focus technique : comprendre les éléments clés de la réforme
Les formats acceptés : Factur‑X, UBL, CII
L’un des éléments essentiels de la facturation électronique réside dans le format des factures. Pour être conforme à la réglementation, une facture électronique doit être émise dans un format structuré, c’est-à-dire lisible par les machines et exploitable par les systèmes comptables et fiscaux.
Trois formats sont officiellement reconnus dans le cadre de la réforme :
- Factur‑X : un format hybride combinant un PDF lisible et un fichier XML structuré.
- UBL (Universal Business Language) : format standard utilisé dans de nombreux pays européens.
- CII (Cross Industry Invoice) : norme développée par l’ONU, plus technique et très complète.
Le choix du format dépendra du logiciel ou de la plateforme agréée utilisée, mais toutes devront garantir la transmission des données obligatoires selon les exigences de l’administration fiscale. Le simple PDF non structuré ne sera plus suffisant.
Le rôle des plateformes agréées (ex‑PDP)
Les plateformes de dématérialisation partenaires, désormais appelées plateformes agréées, occupent une place centrale dans le dispositif de transmission.
Une plateforme agréée est un opérateur privé ayant obtenu une immatriculation officielle auprès de l’administration fiscale. Son rôle est de :
- Recevoir les factures électroniques émises par les entreprises ;
- Transmettre les factures aux clients via le Portail Public de Facturation (PPF) ou une autre plateforme interconnectée ;
- Assurer le e-reporting des opérations non couvertes par la facturation électronique (B2C, international) ;
- Vérifier la conformité technique des données avant transmission à la DGFIP.
Les entreprises ne peuvent plus passer directement par le PPF. Elles doivent choisir une plateforme agréée ou un opérateur connecté à une telle plateforme pour être en règle.
Le PPF : rôle centralisé, interconnexion et annuaire
Le Portail Public de Facturation (PPF), géré par l’État, n’est pas destiné à être utilisé directement par les entreprises. Il joue un rôle technique dans le système de facturation électronique :
- Il sert de point d’échange central entre les plateformes agréées ;
- Il collecte les données de factures et de e-reporting ;
- Il tient à jour l’annuaire central des entreprises (à partir de leur numéro SIREN ou SIRET) avec les points de réception configurés.
Cet annuaire permet à une plateforme d’identifier vers où transmettre une facture, même si l’émetteur et le récepteur n’utilisent pas la même solution technique. Chaque entreprise devra s’assurer d’être référencée correctement, avec les bonnes informations de routage.
Les données transmises : mentions obligatoires, formats, paiements
La réforme impose que chaque facture électronique contienne un socle de données obligatoires, structuré de manière à pouvoir être analysé automatiquement. Parmi ces données :
- L’identité de l’émetteur (raison sociale, numéro SIREN) ;
- Le numéro de facture, la date d’émission, la nature des prestations ou des ventes ;
- Les montants hors taxe, le montant de la TVA, les taux appliqués ;
- Les modalités de paiement ;
- Les références contractuelles si applicables.
Le respect de ces mentions est essentiel pour garantir la conformité du document. Toute transmission incomplète ou erronée peut entraîner un rejet ou une non‑prise en compte dans les processus de pré-remplissage de la déclaration de TVA.
Le e‑reporting : types d’opérations concernées, obligations, fréquence
Toutes les opérations commerciales ne donnent pas lieu à une facture électronique. C’est le cas notamment des :
- Ventes à des particuliers (B2C) ;
- Exportations ou prestations de services à des clients non établis en France ;
- Achats intracommunautaires ou certaines opérations exonérées.
Pour ces cas, les entreprises devront effectuer un e-reporting, c’est-à-dire transmettre un ensemble de données fiscales à l’administration via leur plateforme agréée. Ces données comprennent les montants, la nature de l’opération, la date, la TVA éventuellement facturée, etc.
Le e-reporting devra être réalisé selon une fréquence définie (souvent mensuelle ou hebdomadaire selon l’activité). Là encore, les outils choisis doivent permettre l’automatisation et la sécurisation de ces transmissions.
Comment s’y préparer concrètement ?
La réussite de la mise en œuvre de la facturation électronique repose sur une bonne anticipation. Attendre la dernière minute expose les entreprises à des risques techniques, organisationnels et fiscaux. Voici les principales étapes à suivre pour se préparer dans les temps, quel que soit le niveau de maturité numérique ou la taille de la structure.
Vérifier son statut TVA
La première étape consiste à déterminer si l’entreprise est bien assujettie à la TVA. Ce statut, même en cas de franchise en base, entraîne des obligations : au minimum la réception de factures électroniques, et potentiellement le e-reporting. Il convient donc de vérifier sa situation au regard du Code général des impôts, et de s’assurer que les bons interlocuteurs en interne sont sensibilisés.
Identifier ses besoins et son niveau de digitalisation
Une entreprise équipée d’un logiciel de gestion ou d’un ERP devra vérifier si son outil est ou sera compatible avec les formats de factures électroniques exigés (Factur‑X, UBL, CII) et avec une plateforme agréée. Une structure plus légère, qui facture manuellement ou avec un tableur, devra envisager une solution simple ou passer par un opérateur de dématérialisation.
L’objectif n’est pas forcément de transformer l’organisation, mais de s’assurer que les outils utilisés permettent de respecter les obligations de transmission, de réception et, le cas échéant, de e-reporting.
Choisir une plateforme agréée (ou un prestataire connecté à une plateforme agréée)
Le choix de la plateforme de dématérialisation partenaire est une étape clé. Elle doit être immatriculée par l’administration fiscale et capable de gérer la totalité des flux de factures, ainsi que les éventuelles déclarations de données liées au e-reporting.
Certaines entreprises opteront pour une intégration directe avec leur outil de gestion, d’autres pour une plateforme externe via une interface web. Il est également possible de passer par un opérateur intermédiaire, qui prendra en charge la transmission via une plateforme agréée.
S’assurer que les logiciels sont compatibles
Si un outil de facturation est déjà en place, il convient de contacter l’éditeur ou le prestataire pour s’assurer que :
- les formats exigés (Factur‑X, UBL, etc.) sont bien gérés,
- la solution est reliée ou pourra être reliée à une plateforme agréée,
- les fonctionnalités nécessaires (suivi, archivage, génération des données de e-reporting) seront disponibles.
Une mise à jour peut être nécessaire. Il est préférable de l’anticiper afin d’éviter un engorgement à l’approche des échéances de septembre 2026.
Se référencer dans l’annuaire PPF (SIREN, SIRET, routage)
L’annuaire du Portail Public de Facturation (PPF) est un élément central du dispositif. Il permet à chaque plateforme agréée de savoir vers où router les factures électroniques émises. L’entreprise doit y être référencée avec :
- son numéro SIREN (ou SIRET le cas échéant),
- son point de réception des factures,
- sa plateforme de dématérialisation partenaire ou le nom de son opérateur technique.
La vérification et, si besoin, la correction de ces données doivent être réalisées suffisamment tôt pour éviter des erreurs de transmission.
Former les collaborateurs
La facturation électronique implique une évolution des pratiques, en particulier pour les services comptables, administratifs ou de gestion. Il est important de :
- désigner un référent ou un interlocuteur interne,
- expliquer le nouveau cycle de réception, de vérification et de stockage des factures,
- sensibiliser aux nouveaux formats, à l’utilisation de la plateforme et aux points de vigilance,
- anticiper les questions récurrentes avec les clients ou les fournisseurs.
Une formation légère peut suffire pour les plus petites structures, tandis que les organisations plus complexes pourront intégrer ce sujet à leurs projets de transformation digitale.
Conclusion : dépasser les idées reçues pour avancer sereinement
La réforme de la facturation électronique représente un tournant pour l’ensemble des entreprises assujetties à la TVA. Progressivement, elle modifiera en profondeur les pratiques de facturation, de transmission de données, de déclaration de TVA et de suivi administratif. Loin d’être réservée aux grandes structures, elle concerne aussi les TPE, PME, micro-entreprises et auto-entrepreneurs, quel que soit leur secteur d’activité.
Comme nous l’avons vu, de nombreuses idées reçues circulent encore. Certaines reposent sur des pratiques anciennes, d’autres sur une méconnaissance des obligations réelles, ou sur des informations dépassées. Prendre le temps de les déconstruire permet de mieux comprendre les enjeux, de choisir les bons outils et de s’organiser sans subir la réforme.
La réussite de cette mise en œuvre repose sur trois facteurs : l’information, l’anticipation et l’accompagnement. S’informer permet de distinguer les faits des suppositions. Anticiper permet d’éviter les blocages techniques ou organisationnels. Et se faire accompagner, que ce soit par un éditeur, un prestataire ou une plateforme de dématérialisation partenaire, permet de sécuriser sa conformité tout en optimisant ses processus de gestion.
Il ne s’agit pas simplement de remplacer un format de factures. Il s’agit de mettre en place un mode de fonctionnement plus fluide, plus sécurisé, plus lisible. Une évolution qui, bien préparée, peut aussi devenir un levier d’amélioration au-delà de la seule obligation réglementaire.
La réforme est lancée, le calendrier est fixé, et les outils sont disponibles. Le moment est venu pour chaque entreprise de passer à l’action, à son rythme, mais sans attendre.
